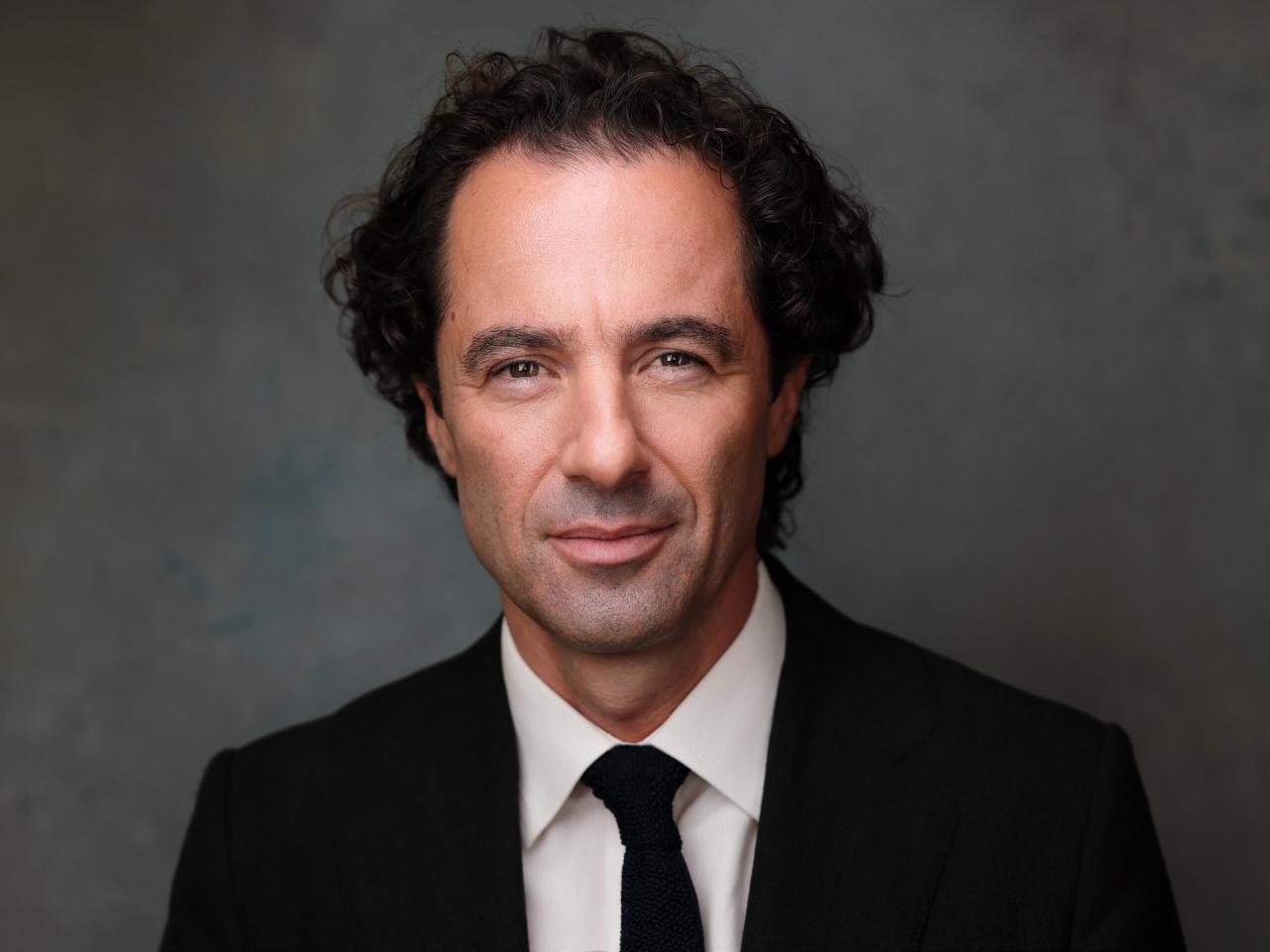
Analyses
Publié le : 28/07/2025
Construire une IA d’intérêt public : perspectives pour le Maroc et l’Afrique
Martin Tisné, fondateur et président du conseil d’administration de Current AI*, partage avec la Newsroom sa vision d’une intelligence artificielle éthique et inclusive. À la croisée de la souveraineté technologique et de l’innovation porteuse de sens, il expose les conditions nécessaires à l’émergence d’une IA d’intérêt public en Afrique – et plaide pour une gouvernance ancrée dans les besoins réels des communautés.
*Current AI est un partenariat mondial novateur lancé à Paris en février dernier lors du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle pour mettre l’intelligence artificielle au service de l’intérêt général.
Vous avez lancé Collaborative AI avec un fonds initial de 400 M$, visant 2,5 Md$ pour financer une IA d’intérêt public. Pour des pays comme le Maroc, comment construire des capacités locales tout en participant à des écosystèmes globaux? Et quelles leçons tirer de votre expérience à l’Open Government Partnership pour garantir une gouvernance éthique, inclusive et réellement participative de l’IA en Afrique ?
Tout commence et finit par demander, écouter et comprendre. Qu’attendent les personnes et les communautés de l’intelligence artificielle ? À quoi ressemble une société où l’IA travaille pour eux, avec eux ?
Cette approche peut aider des pays comme le Maroc à construire trois composantes indispensables pour que l’IA d’intérêt public puisse prospérer : de meilleures données, des écosystèmes d’IA véritablement ouverts, et une responsabilité envers les personnes et les communautés. Cela signifie avoir une compréhension concrète et fondée sur des preuves de l’impact de l’IA sur la société, être transparent à ce sujet, et prendre des décisions en conséquence, tout en étant capable de les justifier. Jusqu’à présent, les écosystèmes mondiaux ont été déficients sur ce plan. Dans ce contexte, développer des capacités locales centrées sur les personnes et les communautés peut permettre à des pays d’aller au-delà d’une simple participation aux écosystèmes mondiaux, pour contribuer activement à les façonner grâce à leurs perspectives uniques et à leur valeur ajoutée.
Le Maroc apporte des contributions essentielles à l’avenir de l’IA en Afrique et dans le monde arabe, mettant en avant une ambition nationale et un engagement à long terme dans la construction de systèmes et d’outils d’IA qui servent l’intérêt public, enracinés dans les valeurs, les priorités, les langues et l’histoire locales. Le travail remarquable du AI Movement Centre de l’Université Mohammed VI Polytechnique, notamment dans l’utilisation de l’IA pour reconnaître les dialectes arabes et dans l’avancement des recherches en neurosciences et en santé mentale, en est une illustration parfaite.

Martin Tisné aux côtés du cofondateur de MGH Partners à Rabat, en marge de la première Conférence nationale sur l’IA – juillet 2025.
L’expérience clé du Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP) réside dans la proximité étroite entre différents groupes de parties prenantes. Lorsque nous avons lancé l’OGP en 2010, le comité directeur était composé à parts égales de représentants du gouvernement et de la société civile, ce qui nous a permis de débloquer de nouvelles innovations et expériences. Une deuxième expérience cruciale concerne la proximité avec le terrain : après avoir débuté au niveau national, l’OGP a lancé « OGP Local » et collaboré avec des villes du monde entier sur les réformes de gouvernement ouvert. Ces deux possibilités me rendent particulièrement enthousiaste.
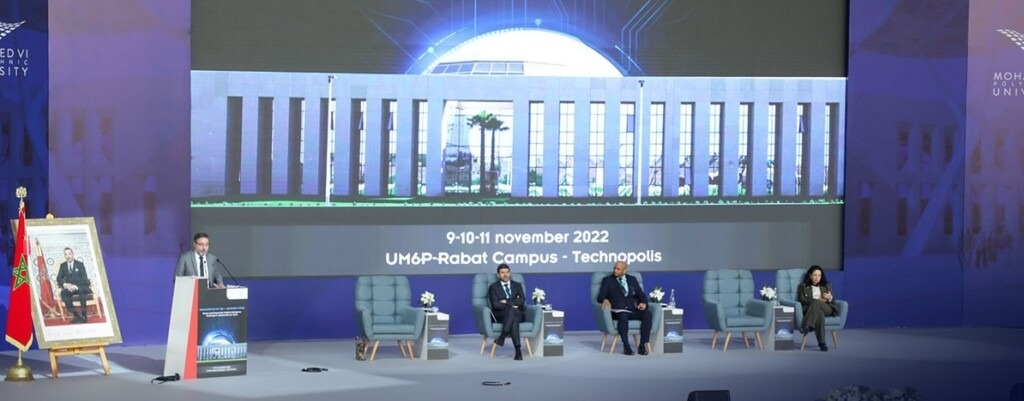
Du 9 au 11 novembre, le Centre AI Movement de l’Université Mohammed VI Polytechnique a lancé l’AI Dome sur le campus de l’UM6P à Technopolis, Rabat.
Vous évoquez souvent l’importance des droits collectifs sur les données pour mieux protéger les communautés, au-delà des droits individuels. Comment ces droits peuvent-ils être concrètement mis en œuvre dans des pays africains où les citoyens partagent massivement leurs données, souvent sans réelle information ou consentement démocratique ? Quelles conditions préalables sont nécessaires ?
Nous devons trouver un équilibre entre les droits individuels à la vie privée et les opportunités (ainsi que les menaces) liées à l’utilisation collective des données. La première condition préalable consiste à déterminer précisément quelle est l’unité d’analyse, ce que signifie exactement le « collectif » dont nous parlons : s’agit-il des patients d’un hôpital spécifique ? Des parents d’une école donnée ? Des personnes souffrant de la même maladie ? Commençons par des études de cas très concrètes, puis montons en généralité. Il s’agit à la fois de protéger les communautés et de leur permettre de tirer parti de ces données. Plusieurs approches de gouvernance des données sont pertinentes ici, allant des fiducies de données aux coopératives de données.

Johannesbourg © Sopotnicki
Dans un contexte où l’Afrique, et notamment le Maroc, cherchent à attirer des investissements privés pour construire leur écosystème IA, comment concilier la logique d’intérêt public et l’attractivité économique? Et sur la question de l’infrastructure : faut-il prioriser la souveraineté technologique (clouds nationaux) ou accepter une certaine dépendance pour plus d’agilité et d’efficacité ?
Interrogeons d’abord le présupposé selon lequel l’intérêt public et l’attractivité économique seraient antagonistes. La création et la fourniture de valeur sont au cœur de la théorie et de la pratique dans le domaine de la gestion, de l’entrepreneuriat et du business, même si tous les acteurs n’adhèrent pas nécessairement à cette approche ou ne l’adoptent que de manière rhétorique. Peut-être donc ne s’agit-il pas tant de réconcilier l’intérêt public et l’attractivité économique, mais plutôt d’encourager et de financer les bâtisseurs et innovateurs qui construisent avec une finalité précise, cherchant le profit comme résultat crucial mais pas comme objectif principal, visant avant tout à résoudre des problèmes urgents pour apporter de la valeur aux populations.
En parallèle, il faut reconnaître que les marchés sont imparfaits et souvent mal optimisés pour encourager la création et la fourniture de valeur publique. C’est un obstacle, mais pas insurmontable. Développer une IA centrée sur une finalité d’intérêt public permet de produire des résultats sociétaux significatifs tout en favorisant des percées technologiques, générant ainsi une innovation plus résiliente, pertinente et prête pour l’avenir. Une approche centrée sur l’intérêt public aide les nations et les innovateurs à équilibrer les bénéfices sociétaux à long terme avec les intérêts nationaux, la compétitivité économique et le leadership technologique – démontrant qu’à leur meilleur, ces objectifs se renforcent mutuellement. Ainsi, en pratique, il s’agit de favoriser ces bâtisseurs et innovateurs afin que leurs cas deviennent des preuves démontrant que les résultats sociaux et économiques vont de pair. De cette manière, la souveraineté est essentielle dans la mesure où elle renforce les écosystèmes locaux d’innovation. Ce qui compte avant tout, c’est l’impact durable sur les populations.

Data centers © Google
Vous avez contribué à la loi République Numérique en France, qui prône la transparence algorithmique. Comment ces principes peuvent-ils être adaptés dans des pays africains qui manquent encore de capacités techniques pour auditer et comprendre les systèmes complexes? Ne risque-t-on pas d’exclure ces pays des standards internationaux, faute de moyens ?
La loi pour une République numérique est une loi nationale française qui ne définit pas intrinsèquement des normes internationales. Elle consacre principalement la transparence algorithmique spécifiquement pour les décisions automatisées dans le secteur public français.
L’erreur à éviter est que l’État contracte avec des prestataires privés dont il ne comprend pas la technologie et qu’il serait incapable d’auditer.
Fondamentalement, il s’agit d’une question de capacité du secteur public, un défi commun à tous les pays.
L’un des cas emblématiques illustrant cette erreur est celui du système MiDAS dans le Michigan, aux États-Unis. Ce système, destiné à détecter les fraudes aux allocations chômage, s’est avéré incorrect dans plus de 90 % des cas, signalant à tort environ 40 000 dossiers comme frauduleux. Finalement, si un pays – africain ou autre – est prêt à utiliser de tels systèmes pour des décisions automatisées, il doit impérativement les comprendre et être en mesure de les auditer en toute confiance.

Emmanuel Macron prend la parole lors de la session plénière du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle, à Paris, le 11 février 2025. (LUDOVIC MARIN / AFP)


